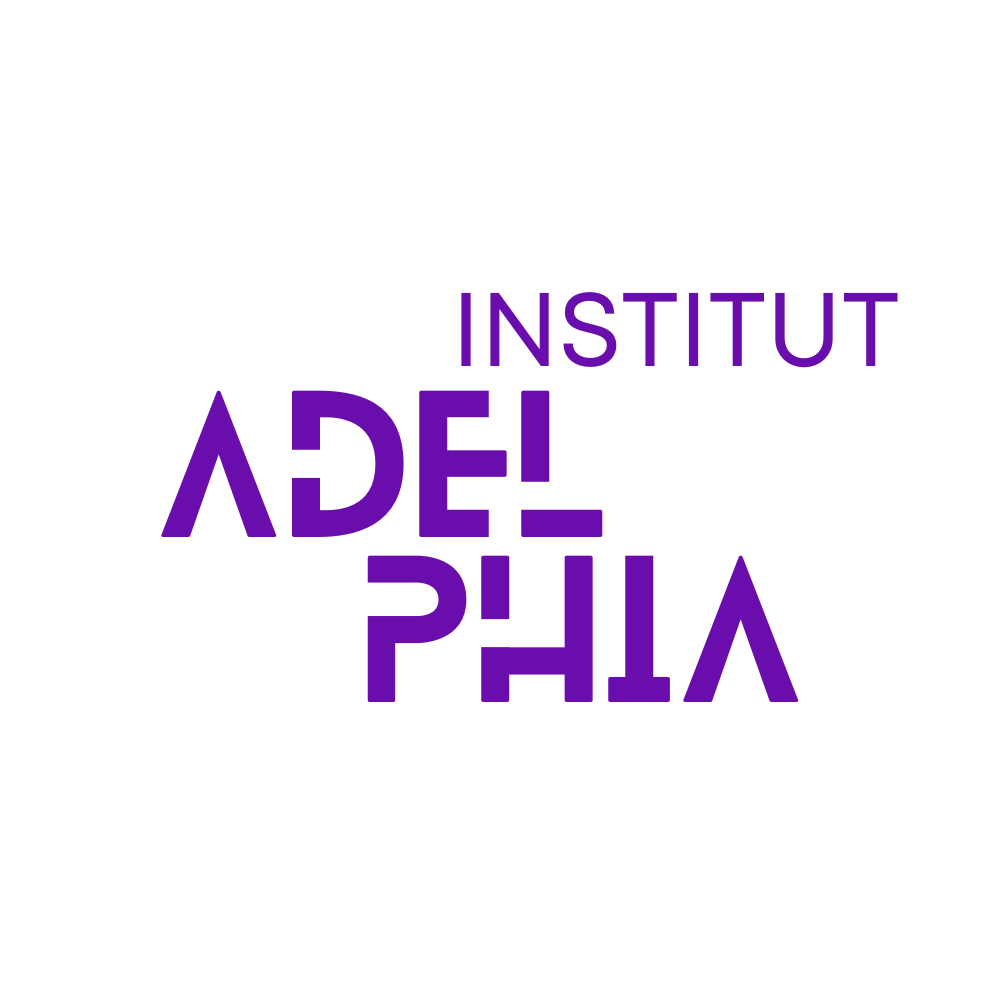Dans notre société occidentale, les symboles de la puissance et de la domination masculine sont omniprésents. Des monuments tels que l’Obélisque de Louxor à Paris, la Colonne de Nelson à Londres ou la Tour de Pise en Italie en sont des exemples emblématiques. Leur architecture phallique domine l’horizon urbain et se dresse comme des manifestations visibles de l’occupation masculine de l’espace public, célébrant guerres et conquêtes à la gloire de la suprématie masculine. A l’instar du Panthéon dont la devise annonce un « Temple à la gloire des grands hommes ». Quid des grandes Femmes ? Question assez récemment posée grâce aux mouvements féministes.
Cette représentation excessive de symboles masculins dans l’espace public reflète et renforce des dynamiques de pouvoir profondément enracinées. En utilisant les concepts sociologiques et psychologiques d’intériorité et d’extériorité, cette réflexion partagée explore l’impact de ces symboles sur la société et les individus, en particulier sur les femmes. Elle propose une critique des implications de cette omniprésence et une mise en perspective de ce qui doit changer.


L’omniprésence des symboles masculins
Les symboles phalliques de force et domination sont omniprésents dans notre environnement. Souvent célébrés comme des merveilles d’ingénierie et des témoignages de progrès. L’Obélisque de Louxor, érigé sur la place de la Concorde à Paris, en est un exemple frappant. Ce monument, offert par l’Égypte à la France en 1830, est une manifestation de la puissance et de l’autorité d’un Empereur colonisateur à dessein hégémonique.
La Tour Eiffel, célébrée comme un exploit architectural, constitue la paradoxale représentation d’une Dame… de fer, érigée en hauteur.
Ces structures ne sont pas des exceptions mais des normes dans nos villes. Les gratte-ciels, les colonnes, certaines sculptures et œuvres d’art participent à cette glorification de la forme phallique. Ces symboles agissent comme des rappels constants de la domination masculine, marquant physiquement et psychologiquement le paysage de nos vies quotidiennes et absorbant les esprits, réduisant l’humanité au genre dominant : le masculin.
Intériorité et extériorité dans la représentation
Le concept d’intériorité et d’extériorité est crucial pour comprendre l’impact des symboles masculins omniprésents. À un niveau fondamental, cette ségrégation aux dépens du genre féminin résulte d’une instrumentalisation sexiste des caractéristiques physiques de nos sexes respectifs. Le sexe masculin est externe et visible, symboliquement tourné vers l’extérieur, valorisé par sa capacité érectile pénétrante. Il domine l’espace public. Par contraste, le sexe féminin est interne, caché, symbolisant l’intériorité et la sphère privée. Cette distinction biologique a été historiquement manipulée et mythifiée, renforçant des stéréotypes de genre largement prégnants.
L’intériorité du sexe féminin a conduit à une méconnaissance historique et à une mystification. La visibilité du sexe masculin a contribué à son culte antique, à un continuum historique propageant sa représentation dans l’art, l’architecture et les symboles de pouvoir dans la majorité des cultures. En revanche, la nature cachée du sexe féminin a suscité des fantasmes et des peurs, alimentant mythes, tabous et disqualifications qui ont souvent marginalisé et opprimé les femmes. Les menstruations sont souvent perçues comme sales et motif d’exclusion. Domination et méconnaissance ont généré un déséquilibre de la valeur attribuée à l’un — le masculin — et récusée à l’autre — le féminin —. La langue française, structurée autour de cette discrimination fondatrice -à partir du 17ème siècle avec l’Académie française exclusivement masculine-, n’a fait qu’entériner cette naturalisation d’un genre dominant versus un genre dominé.
La crainte de ce qui est caché, inconnu est un phénomène psychologique bien documenté. Cette peur de l’inconnu, combinée à l’érectilité brutale de l’organe masculin, a renforcé des dynamiques de pouvoir inégales. D’autant plus que la chasse aux sorcières qui a marqué le Moyen-Âge a décimé la communauté des femmes savantes — puissantes, guérisseuses, libres penseuses, transmetteures de savoirs immémoriaux —. Les symboles phalliques, en tant que manifestations visibles de la masculinité, deviennent alors des icônes de contrôle et de puissance. Ils dominent la relation sociale et l’espace public, rappelant constamment la suprématie masculine, la normalisant, l’instituant.
Cette représentation symbolique influence profondément la perception de soi dans le rapport aux autres. Les populations, en subissant un environnement dominé par des symboles masculins, intériorisent l’idée que le rôle des femmes est subsidiaire, relégué au foyer, aux enfants, comme cloisonné au service du mâle dominant. Conditionnées par ces limites, les femmes se sentent moins légitimes à occuper l’espace public, ce qui contribue à juguler leurs ambitions, à réprimer leurs comportements dissidents et à dissuader des actions de résistance ou de reprise d’espace toujours sujettes à représailles.
De plus, ce déséquilibre de visibilité entre les sexes participe à la sexualisation des corps féminins, bornés à être investis comme des objets assujettis aux caprices du regard masculin. Le sexe féminin fait tout au plus l’objet d’une curiosité malsaine et donne lieu à des représentations fantasmées souvent déconnectées de la réalité de l’expérience des femmes. Ce qui perpétue des stéréotypes de genre nuisibles et renforce les inégalités.
En analysant cette dualité entre intériorité et extériorité, nous voyons comment les structures de pouvoir sont non seulement maintenues, mais aussi justifiées par des représentations symboliques. La société valorise ce qui est visible et tangible, laissant dans l’ombre ce qui est caché, intérieur. Pour déconstruire ces dynamiques, il est essentiel de reconnaître et de remettre en question les symboles qui perpétuent ces inégalités.
Impact sociologique et psychologique sur les individus
L’impact de ce système construit sur la surévaluation du masculin façonne mentalités et comportements. Sociologiquement, la domination masculine via des symboles phalliques dans l’espace public contribue à maintenir les structures patriarcales. Forme de conquête territoriale diffuse qui marque le Corps social en légitimant le pouvoir, l’autorité et la violence masculines. Cercle vicieux de la domination autoproclamée, validée en circuit fermé par son propre reflet spatial. Un environnement saturé par l’omniprésence masculine — le nom des rues par exemple —, induit une invisibilisation des femmes constamment rappelées à leur place subordonnée.
Psychologiquement, cette omniprésence affecte l’estime de soi et la perception du pouvoir, par les femmes elles-mêmes. La théorie de la « menace du stéréotype » suggère que les femmes doivent se conformer à la place à laquelle elles sont assignée, la seule à laquelle elle sont censées pouvoir prétendre : nécessairement moindre, dépendante, corsetée. Inconsciemment ou volontairement, les stéréotypes de genre font écho à cette hiérarchie, qui démobilise les femmes dans leurs capacités naturelles à se développer. Par anticipation invalidante, le fameux plafond de verre fait partie des expériences féminines dans toutes les sphères de leur existence. Leurs participation et performance dans des domaines dominés par les hommes relèvent du parcours de la combattante — dans certains métiers notamment—. Obligées pour repousser les murs de leur prison à surmonter apriori et prescriptions sociales sexuellement normées — par le patriarcat, la religion, l’organisation sociale et politique —, elles doivent mettre les bouchées doubles pour sortir de l’ombre dans laquelle elles sont confinées; démultipliant efforts, études, conflits de résistance pour dépasser croyances limitantes et jugements conservateurs ou carrément réactionnaires. Vécues comme une menace pour l’ordre établi ou comme de discréditants facteurs de concurrence, les femmes doivent se battre pour accéder aux droits fondamentaux : lire, voter, travailler, disposer de leur corps…
L’espace public « trusté » par les hommes n’est que l’expression de cette dichotomie socialement construite et politiquement soutenue. Privilège de classe de genre défendu par les masculinistes, y compris dans la violence.
Exemples supplémentaires et analyse critique
Au-delà des monuments, de nombreux autres exemples illustrent la domination masculine symbolique, tangible et réelle. Le Washington Monument aux États-Unis, les gratte-ciels de Manhattan, et même certaines œuvres d’art public telles que les colonnes de Buren au Palais Royal à Paris participent à pérenniser la glorification de la forme phallique. Tradition bien ancrée, qui attend encore une profonde déconstruction.
Ici renvoyer à des références et noms d’artistes.
Ces symboles ne sont pas seulement des artefacts historiques ou architecturaux; ils sont des outils de pouvoir qui perpétuent les inégalités de genre. Leur présence constante et imposante contribue à une culture où la masculinité est valorisée comme supérieure, tandis que la féminité est rabaissée — relégation aux tâches domestiques, à l’artisanat, au plaisir des hommes—. Sans compter que même les femmes découvreuses, historiquement célèbres — scientifiques, écrivaines…— ont été minorées, leurs découvertes usurpées, leurs récits « male gazés ».
Conclusion
La représentation excessive des symboles masculins dans nos sociétés est une manifestation de la domination patriarcale. Intériorité et extériorité traduisent comment ces symboles façonnent les dynamiques de pouvoir et formatent les comportements sociaux, grèvent les relations entre femmes et hommes à l’intérieur comme à l’extérieur (spères privée-publique). Les hommes monopolisent l’espace public marqué du sceau du danger et de la potentielle violence masculine; les femmes sont souvent contraintes d’en éviter la fréquentation.
Pour progresser vers une société plus équitable, il est crucial de prendre consciences de ces inégalités et de remettre en question les représentations qui en sont à l’origine.
Pour aller au-delà de la critique, nous devons imaginer et créer des espaces publics qui célèbrent la diversité et l’égalité des genres. Cela devra inclure des monuments honorant la féminité, l’intégration d’œuvres d’art attestant des expériences et des contributions des femmes. La révision des espaces existants pourra ainsi refléter une vision concrètement inclusive de notre société. En valorisant les symboles de la puissance féminine, tels que les sculptures et installations artistiques représentant la vulve, le clitoris, l’intime, la sensibilité, le soin et toute forme de témoignage féminin, nous pourrons contrebalancer les diktats patriarcaux et promouvoir une culture du respect et de l’égalité.
En redessinant les formes et contenus de notre environnement visuel et symbolique, nous contribuons non seulement à l’émancipation des femmes, mais également à la création d’une société où chaque individu peut se sentir représenté et valorisé. Cette transformation est essentielle pour construire un futur plus juste et harmonieux, où les contributions de tous les genres sont reconnues et célébrées.
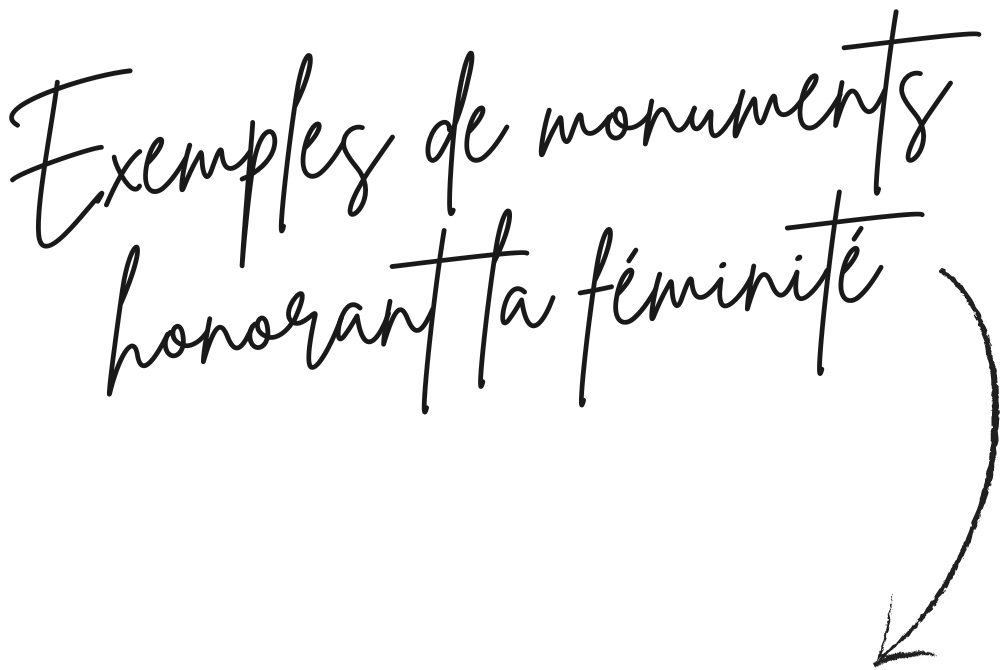




Sources et inspirations :
Pour approfondir les réflexions abordées dans cet article, plusieurs sources et œuvres ont été consultées.
Pierre Bourdieu, dans son ouvrage sur la domination masculine, offre une analyse sociologique pertinente (https://www.cairn.info/pierre-bourdieu–9782912601780-page-67.htm).
Titiou Lecoq retrace l’histoire des femmes oubliées dans « Les Grandes Oubliées » (https://www.librairie-des-femmes.fr/livre/9782493909466-les-grandes-oubliees-titiou-lecoq/).
Mona Chollet explore la figure des sorcières et leur persécution historique dans « Sorcières » (https://www.editionsladecouverte.fr/sorcieres-9782355221224).
Des artistes comme Joana Vasconcelos (https://fr.wikipedia.org/wiki/Joana_Vasconcelos), Louise Bourgeois (https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Bourgeois_(plasticienne)), et Niki de Saint Phalle (https://fr.wikipedia.org/wiki/Niki_de_Saint_Phalle) interrogent la place des femmes dans l’art et l’espace public.
L’ouvrage « Vers une architecture de la jouissance » examine les liens entre architecture et émancipation féminine.
Des initiatives comme la nomination de rues en hommage aux femmes sont également mentionnées.
Le collectif NousToutes milite pour l’égalité des genres et la fin des violences sexistes, et à lancé une initiative de sécurisation de l’espace public.
Enfin, « Les Figures de l’ombre » met en lumière les contributions souvent méconnues des femmes de science.