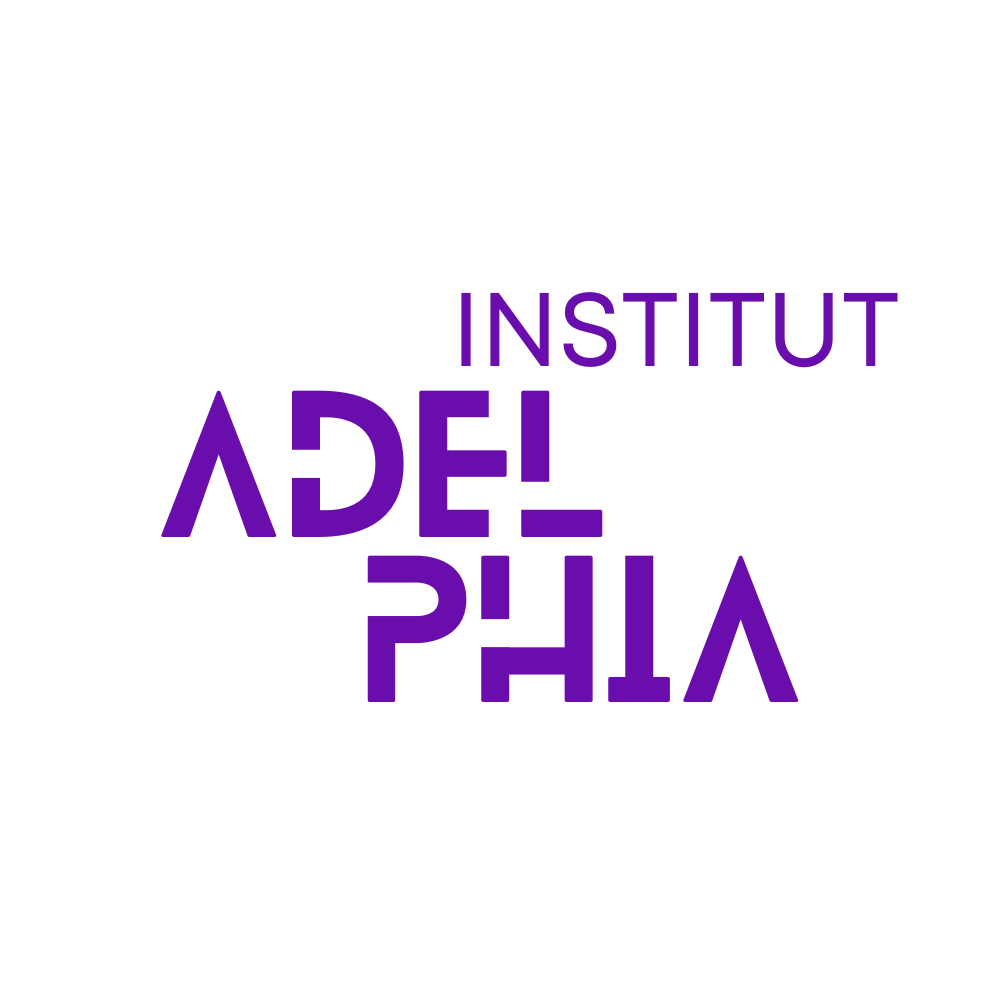Le saviez-vous ? Quand une personne trans veut se faire administrativement reconnaitre, au-delà du changement de son prénom (directement auprès de l’état civil de la Mairie), elle doit passer devant un juge pour faire reconnaitre son nouveau genre. Cette judiciarisation limitée au genre pose question dans sa forme comme dans le fond.
S’accorder avec son identité de genre reste une vraie gageure dans une société du contrôle de la conformité des corps.
Dans un véritable État de Droits, on pourrait espérer que la transition des personnes soit une formalité simple, assurée par une reconnaissance juridique protectrice des effets acquisitifs d’une nouvelle identité : nouveau prénom, nouveaux papiers d’identité, nouveau numéro de sécurité sociale ; pour que sur le plan administratif la personne soit intégralement couverte et n’ait à souffrir d’aucune dissonance, dans ses relations sociales notamment.
Le principe de l’autorité de la chose jugée garantit au justiciable l’irrévocabilité de la décision juridique rendue. Rendant l’identité accordée par exemple absolument irrévocable, quel que soit le contenu de l’acte de naissance de la personne (sexe biologique mentionné) et quels que soient les changements de régimes politiques.
Or, en France au 21ème siècle, ce n’est ni la souveraineté des corps ni l’impératif de protéger les personnes trans qui l’emporte, mais bien l’imposition d’un système d’inspection intrusive, de surveillance déplacée et d’évaluation de légitimité.
La transition de genre est tributaire d’une appréciation genrée, fondée sur des critères d’ordre stéréotypé. Un regard absolument binaire se répercute sur la personne et la subordonne à ressembler au modèle Homme ou Femme dominant, c’est à dire socialement défini comme acceptable. La personne doit physiquement correspondre au patron et ainsi pouvoir témoigner de sa réassignation à un genre.
C’est à peine si on ne vérifie pas de quel sexe cette personne est porteuse. Comme si l’identité de genre pouvait se réduire à la biologie.
La Justice reproduit ainsi des biais d’intégration et de rejet, qui vont à l’encontre de l’inclusion effective des personnes.
Partant d’un regard relevant du soupçon, le juge est là pour vérifier dans quelle mesure la personne se rapproche suffisamment du stéréotype de genre. Pour se faire, il se réfère aux attributs prévalents de la masculinité et de la féminité et met en miroir la personne pour décider si oui ou non celle-ci rentre bien dans la case prescriptive du masculin ou du féminin.
La question sous-jacente étant : cette personne mérite-t-elle d’être reconnue femme ou homme au regard des critères dominants ?
Aucune place pour le non binaire, le « je ne ressemble à rien de connu et alors ? ».
Ce processus judiciaire oblige chaque personne trans à se justifier physiquement et donc à se conformer aux attentes du regard social qui pèsent sur les corps.
Ce regard est patriarcal. Pour être perçue comme une femme, il a été déterminé qu’on doit être dotée de seins protubérants, de formes et surtout pas de poils. Porter de préférence les cheveux longs, s’habiller en jupe, se coiffer et présenter un visage plutôt fin. Avoir une corpulence pas trop musclée, être maquillée.
Ces diktats figent les éléments constitutifs d’un genre dans une zone barbelée, qui n’est ni plus ni moins qu’un formatage produit par les hommes et pour les hommes, pour contenter leurs préjugés et préférences relatives aux femmes. Ce regard hétéronormé hiérarchise les femmes entre elles. Le type poupée Barbie est très prisé, le type Patty Smith beaucoup moins. Entrer dans le moule devient un enjeu de reconnaissance sociale. La plupart des femmes s’y soumettent.
Les femmes trans doivent de surcroît attester en justice de leur bonne foi : « oui je suis une femme. Regardez ça se voit ! ». Se conformer à ce qui relève le plus possible d’après de ce à quoi une femme doit ressembler et se faire reconnaitre comme telle.
Ce jugement de valeur s’invite ici au détriment de la quête d’identité et renforce l’idée qu’il y aurait des vraies et des fausses femmes. Comme si les femmes trans empruntaient le genre féminin ; ce qui crée évidemment une précarité de genre, une peur intégrée, un complexe de moins-étant.
Toutes les femmes sont disqualifiées quand elles osent ne pas souscrire aux codes de genre. Une série de classifications hétéronormatives vaut ordonnancement des unes par rapport aux autres. Certaines étant considérées comme plus femmes que d’autres.
Cette injustice est une survivance honteuse de l’avant MeToo qu’il est largement temps de dénoncer et d’abolir. D’autant plus qu’on a tendance à regarder de travers celles qui « jouent le jeu » – la femme trans hyper sexualisée. « Putifier » les femmes, qu’elles soient trans ou cis est une manière de libérer la haine, de reconduire les reproches faits aux femmes libres et de cantonner les femmes trans à une imagerie prostitutionnelle.
Si chacune pouvait simplement jouir de la liberté de s’accoutrer comme elle le souhaite, de conserver ou pas son appareil génital d’origine, là oui nous serions toutes libres. Le « patriarchaïsme » défait par la puissance révolutionnaire de notre indépendance – « La puissance invaincue des femmes ». Droit à l’auto-détermination enfin réalisé.
Le segment social dominé -les femmes dans leur pluralité- a donc été conditionné à s’indexer sur le marché de la désirabilité. De sorte qu’elles cherchent à atteindre l’image de la pseudo perfection taxée de sexy pour se sentir exister dans le regard masculin. Les femmes trans subissent à fortiori cette pesanteur puisque apriori elles partent de plus loin. Elles mettent les bouchées doubles dans cette course pour la considération. Et en justice le parcours de la combattante pour la validation du genre n’échappe scandaleusement pas au prisme de la sexualisation.
On réduit ainsi les féminités plurielles à une essence fantasmée digne de gagner des points de désirabilité ou pas. La sexualisation outrancière des femmes se reporte sur les femmes trans, qui se sentent en devoir de correspondre au modèle le plus reconnaissable, le plus coté à l’argus de la féminité. Elles s’imposent souvent d’attester de leur féminité, en réactivant par là-même les stéréotypes du genre, pourtant parfaitement contestables au regard de l’identité de genre. Paradoxe, qui rentre dans le spectre des violences faites aux femmes, mais dont le pouvoir judiciaire se fait le relais..
Or, « on ne nait pas femme on le devient ». Ce qui signifie que l’on peut se structurer comme femme en dehors de toute assignation biologique sexuée et en contestation du modèle unique.
Le développement de toute femme échappe à la norme. La liberté d’être la femme que l’on veut et qu’on assume d’être devrait rentrer dans le champ des libertés reconnues à tout individu.
Une Justice digne de ce nom doit intégrer cette évolution et cesser de traquer le défaut-trans sous prétexte de reconnaissance de genre.