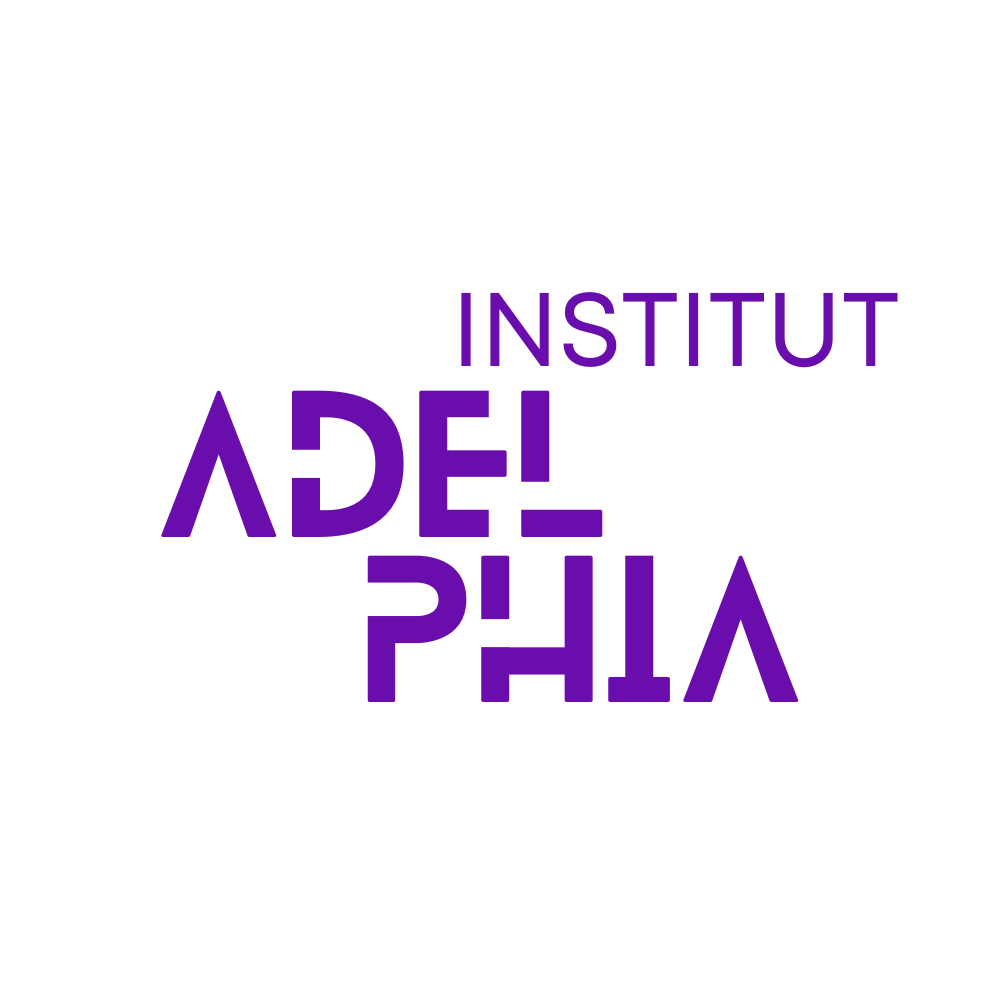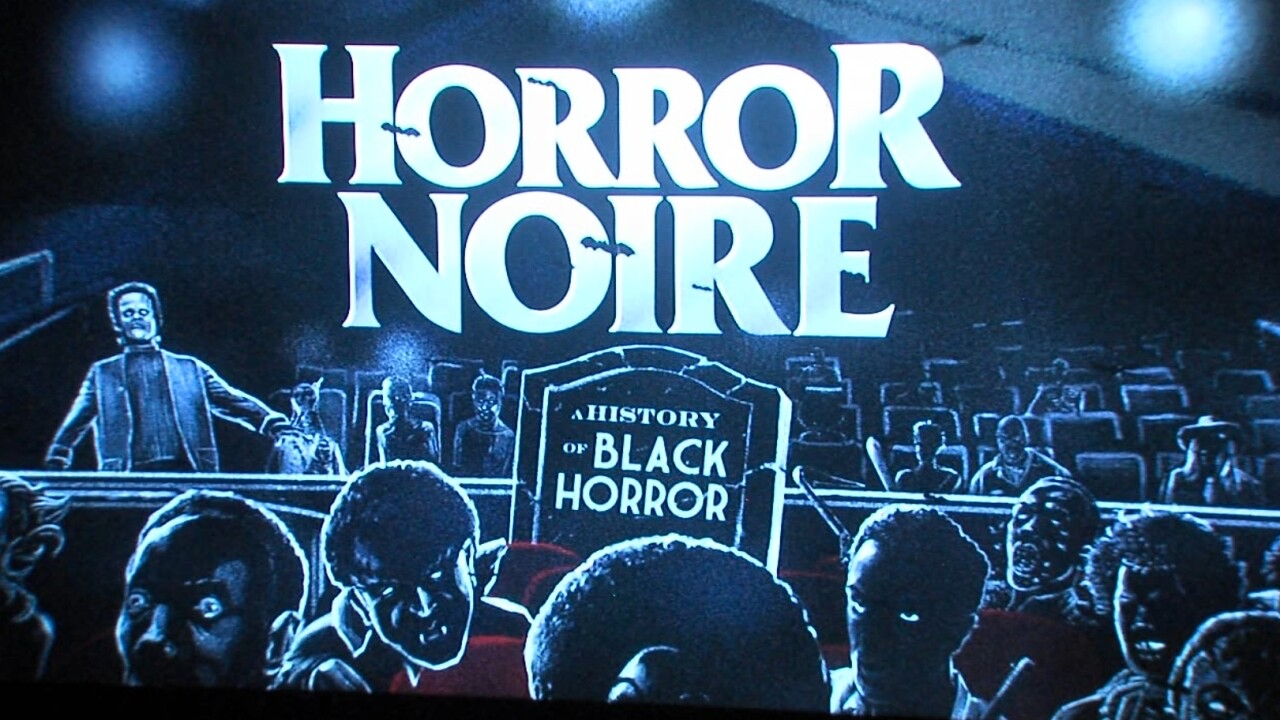Jane Fonda : « Woke means you care about others ».
Être Woke, c’est simplement être conscient.e des injustices, c’est avoir le courage de s’en préoccuper concrètement.
Dans ce contexte, le cinéma devient une puissante arme de conscientisation et de résistance.
Définition et origines du Wokisme
Être woke signifie en avoir quelque chose à faire des autres, prendre soin des autres.
Altruisme-empathie-solidarité-wokisme, même combat !
Le mot Woke trouve son origine au XIXᵉ siècle ; se rapporte à l’expérience des afro-américain.es dans une société post esclavagiste.
Woke veut dire « éveillé.e », sous-entendu face aux dangers quotidiens de l’injustice des blancs (racisme systémique, ségrégation raciale), qui ne digèrent ni l’émancipation des noir.es -vécue comme une perte d’autorité/privilèges, ni le manque à gagner résultant de l’abolition de l’esclavage. Ordre social établi et intérêt économique bouleversés par les droits civiques, vécus par certains comme attentatoires à la domination suprémaciste blanche.
Woke est une mise en garde contre la menace revancharde : « stay woke » plutôt que awaken. Woke, mot d’argot court, sentinelle.
Le mot résonne en condition réelle de libération conditionnelle, comme une recommandation exhortant les noir.es américain.es à une constante vigilance.
Certes elles/ils sont libéré.es du joug de l’esclavage, mais pas de l’exploitation infériorisante, ni des persécutions criminelles du Ku Klux Klan, ni des inégalités raciales qui grèvent leur intégration sociale ; dans un pays où les instituions gangrénées par le racisme systémique et économique (Police, Justice) sont le plus sûr vecteur de reproduction des inégalités. Même quand un noir a suffisamment d’argent pour se payer le luxe d’un Cabinet d’avocats aux petits soins, il risque plus gros qu’un blanc à chef d’accusation identique.
D’autres combats politiques – lutte syndicale, lutte pour les droits civiques – vont parachever l’entrée du terme woke dans le champ politique, au point d’être étendu et réapproprié par l’espace européen.
Plus récemment, à la suite du mouvement « Black Lives Matter » (qui connaitra nombre de déclinaisons plus ou moins supportables) – séries de mobilisations en réaction aux meurtres de personnes noires systématiquement commis par des policiers blancs peu ou pas sanctionnés – le mot Woke devient le porte étendard du ralliement pour l’égalité des droits et la dignité humaine, au-delà du périmètre afro américain.
Il se propulse au cœur du mouvement intersectionnel, qui fait converger différentes luttes -féministe, anti capitaliste, LGBT- en une cohérence globale, dont le ressort est la résistance au cumul d’oppressions et violences.
Une nouvelle ère abolitionniste voit le jour : contre la domination en général, contre ses injustices et crimes en particulier.
Wokisme vs Anti-wokisme : deux visions du monde
On est loin de l’idéologie sectaire que les anti woke affectionnent de brandir comme une menace civilisationnelle. L’ordre normatif confit dans un
patriarcat archaïque gardien du trium-vira « travail-famille-patrie » est mis en déroute. La dévotion aliénante au masculinisme colonisateur a vécu. Les codes changent. L’ancien monde s’effondre. Son obsolescence programmée est longue à la détente, alors que la planète agonise sous l’effet de nos pollutions irresponsables.
La destruction s’accélère, les écarts se creusent, l’ethnocentrisme nous fait perdre une part d’humanité : l’empathie. Continent de plastiques à la dérive, désert éthique, médiocrité politique, complicité médiatique contribuent à assassiner le Vivant. On féminicide, on écocide, on fascise.
Nos critères d’humanité bornés lèvent le voile sur un système à bout de souffle qu’il est temps que l’Histoire balaie d’un revers de conscience. Comment ? Par la reconnaissance de nouveaux droits envers les « animautres » (animaux et autres êtres vivants considérés avec empathie), par une forme de résilience créative (envers le Vivant) et en restaurant les liens rompus avec notre Anima : l’âme/le souffle de la Vie.
Pour que nous puissions envisager un avenir soutenable, un équilibre pacifique, une énergie collective renouvelable, un vivre ensemble inaliénable et sacré, connecté à la Nature.
D’où parlent ceux qui font du Wokisme un épouvantail politico-médiatique ? Quel projet de société défendent-ils ?
Ils disqualifient les personnes qui s’insurgent contre le conditionnement consumériste et l’emprise des discriminations systémiques, mais au nom de quels intérêts ?
Suprémacistes blancs à la masculinité toxique OU intégristes religieux rigoristes OU milliardaires belliqueux, ils fantasment une pureté idéale (de la race, des femmes, des coutumes, de l’argent).
La religion devient leur prétexte commun pour diviser, maltraiter, humilier, anéantir.
Leur but : maintenir un ordre social strictement conservateur et hiérarchique favorable à leur domination (homme/femme, blanc/noir, humain/autres espèces, valide/handicapé).
Leur sentiment d’appartenance à une communauté transite par des pratiques prédatrices, racistes, hégémoniques et excluantes. Une hiérarchisation des genres, origines, orientations sexuelles, justifiant tous les rejets et phobies et crimes…
Invalider la différence au profit de stéréotypes normatifs prescripteurs d’une attitude stigmatisante, faites de violences les réconfortent.
La simple existence de celles et ceux qui échappent au moule s’en retrouve niée, écrasée, au bénéfice du blanc-seing mâle dominateur.
Un monde régenté par la loi du plus fort, du pouvoir qui divise pour régner en maitre sur : la femme, l’esclave, l’infériorisé, le pris pour faible, le soi-disant dénué de valeur.
Par la force, assoir son autorité demeure un enjeu pour ceux qui renforcent un carcan foncièrement segmenté, inégalitaire et injuste.
Particulièrement agressif, ce modèle viriliste civilisationniste et cloisonnant rejette toute divergence.
A contrario, « l’internationale cosmopolite », comme l’appellent les anti woke, représente une voix intégrative de nos différences. Elle prône l’inclusion comme horizon d’une évolution humaine n’adhérant pas à la théorie du « choc des cultures ».
Le wokisme prétend relier les un.es et les autres, au-delà des biais et frontières physiques et mentales. Il s’agit de jeter des ponts, favoriser des rapprochements, accueillir positivement la diversité comme une richesse ; pour fédérer autour d’un idéal commun profondément humaniste.
Des lois équitables valables pour tous.tes, applicables à chacun.e, en contre-point des murs érigés par les anti-woke, voilà le projet de la mondialisation d’un référentiel incubateur de diversité, porteur de valeurs pacificatrices, intégrateur du Vivant, agrégateur de chance à choix multiples.
Ce prisme prend le contre-pied d’une domination ultra libérale offensive, techno-addictive, tentée par une fascisation manipulatoire en guise de phase terminale.
Jane Fonda : un cinéma engagé et humaniste
Jane Fonda se dit Woke. Elle opère une synthèse depuis son promontoire de femme blanche privilégiée, d’actrice de renommée internationale. Elle fait ruisseler une idéologie soit sévèrement réprimée (Russie, USA, Hongrie) soit médiatiquement critiquée (France, Italie) par les tenants des conflits inter-civilisationnels.
Jane F soutient un mouvement de justice sociétale, souvent mal compris, dans un monde à l’envers, traversé par des crispations identitaires, des polarisations dites irréconciliables et une apocalypse informationnelle technologique en ordre de bataille.
L’actrice choisit son rôle, choisit son camp, considérant que le cinéma a sa place dans le débat et peut peser de tout son poids. Art populaire, art de faire la guerre aux idées reçues.
Et estimant que sa notoriété ouvre la voie ; considérant aussi qu’elle est en droit – à minima – de se préoccuper du sort de la femme noire, du misérable SDF privé de protection sociale, du destin du travailleur latino immigré reconduit à la frontière par les sbires de l’Administration Trump.
En fixant cette définition simple de ce qu’est le wokisme, Jane marque les esprits du sceau d’un Cinéma incarné, engagé, résistant. Elle se préoccupe par extension de la personne en transition et de tout sujet humain, qu’il soit handicapé, âgé ou autre.
Icône du 7ème Art, Jane Fonda estime qu’étant éveillée aux autres, elle est en capacité, quelle que soit la différence de l’autre, de le regarder dans les yeux de son humanité. Et réciproquement, celui-ci peut la regarder s’animer lors de la remise de ce prix à la Télévision.
Depuis son piédestal, elle fait le job, descend à hauteur de femmes et d’hommes réels qui n’ont rien à voir avec sa brillante carrière cinématographique, mais tout à voir avec sa résonante humanité.
Alternative à la détestation d’Autrui, le Wokisme défend la progression de conscience ; être sensible au sort d’Autrui, se sentir concerné par l’expérience individuelle ou collective de catégories de populations dites minoritaires et subissant une variété d’oppressions, c’est intégrer que l’autre c’est potentiellement moi : humain singulier avec une trajectoire de vie particulière, tout aussi digne d’exister que moi.
Le wokisme n’est pas un idéalisme. C’est une conduite accompagnée par les autres. Une forme concrète d’intérêt général à vivre éveillé, lucide, sans réduire sa vie à un égoïsme indifférent ni à une assignation dépourvue de remise en question et de conscience réflexive.
C’est aussi le droit de refuser d’être l’objet de limitations contraignantes et d’odieuses exclusions. C’est s’autoriser à soutenir l’auto détermination d’autrui, propice à la réalisation de tous, en interrelations multiples : en famille, à l’école, au travail. Liberté-Egalité-Fraternité. La devise républicaine est woke par essence et nos alliances le sont nécessairement.
Principes humanistes d’ordre universaliste, indépendamment de la couleur, des origines, de la classe sociale, du genre… Le wokisme représente une conscience éveillée, des actions incarnées, qui englobent tous les Autres en reconnaissance d’humanité.
Le Cinéma comme arme culturelle : de la Blaxploitation au Black Horror
Si l’on observe la condition des afro américains, due à l’Histoire de l’esclavagisme et de l’apartheid aux USA, on constate encore au 21ème siècle la persistance d’inégalités révoltantes.
Le pourcentage de cette population condamnée incarcérée dans les prisons US atteste d’une réalité héritée de l’injustice des débuts.
Les relations sociales entre blancs et noirs reposent encore sur des atavismes de peur, suspicion, méfiance… Et le métissage n’est pas si répandu.
L’élection de Donald Trump a cruellement réactivé la cicatrice historique du dénigrement des uns au profit des autres.
Un récit en forme de « il nous faut dire la vérité et mettre en perspective cet héritage enfermant » émerge pourtant de la part du segment dominé.
A la représentation dominante, qui a aliéné les esprits et dégradé l’objectivité d’institutions engluées dans un substrat raciste évident, se substitue un narratif des horreurs subies, des luttes menées et des émotions vécues en (rupture, perte, deuil inexprimées).
Le noir archétypal bestialisé, réduit au rang de marchandise, d’homme violent, grossier, sans éducation, féroce, ou de femme libidineuse qu’on peut donc violer à loisir, objet de tortures estimées méritées puisque femme ou homme présenté comme dénué d’affects, sans âme, est enfin remplacé par l’être humain qu’elle/il est : noir invisibilisé, victime de la traite négrière, durablement abîmé, enfermé dans une histoire sur laquelle il n’avait pas la main.
Il surgit ainsi de l’ombre à travers de nombreux films chocs qui racontent l’exil, la terreur, l’animalisation, les maltraitances et souffrances, le traitement ignoble infligé à des êtres humains du seul fait de leur couleur de peau.
Qu’il soit décrit comme le « bon sauvage » soumis ou comme l’infâme ingrat révolté « neg marron », la figure du Noir -femme ou homme- dit tout du tortionnaire blanc qui a construit cet imaginaire dichotomique, sacrifiant la vérité sur l’autel d’une population déportée, réduite en esclavage, disséquée, désintégrée.
Le noir que l’on disait dangereux, sans Histoire n’était vu qu’à travers le regard carcéral du blanc. Dépendant de lui, encore et toujours.
Privé de sa destinée, mais enfin réhabilité dans la réalité de sa condition, il a été traqué, exporté loin de ses origines africaines, de son clan, de sa structure familiale. Déraciné, soumis à d’atroces privations, ni reconnu pour sa conscience ni considéré dans sa dignité.
Victime de la projection malsaine infligée par le « maître » blanc cupide, abusif, violeur et meurtrier, ce Noir réel reprend enfin ses droits pour raconter LA vérité. Pas la version officielle orchestrée par les blancs. Plutôt les soubassements, ce qu’on a voulu cacher, ne surtout pas révéler.
Procès en cours au cinéma : du racisme biologique au racisme culturel
« Noire créature » prostrée, mise en abîme, l’afro américain.e a vécu.e dans sa chair les traitements les plus inhumains. L’impact transgénérationnel des douleurs endurées accable encore les générations futures, endommage les chances de réussite sociale de la minorité noire aux USA.
Alors c’est à la lumière brute des projecteurs de la dénonciation que le cinéma fait appel pour sortir du refoulement, montrer la vérité -la monstruosité- de l’expérience existentielle des afro américain.es.
Via le canal historique socio-culturel de la Blaxploitation d’abord, on revalorise dans les années 70 l’image des afro américains. « Black is beautiful » resonne au diapson de la chanson « I’m black i’m proud ».
Plus des faire-valoir, plus des rôles secondaires. Au 1er plan, elles/ils incarnent le héros de l’histoire, échappent enfin à la caricature.
Des réalisateurs noirs, des acteurs-actrices noir.es (Marvin Van Peebles, Pam Grier, Richard Roundtree…) endossent différents rôles (flic, vampire, cowboy, militaire, espion, humoriste raté…). Ils occupent le champ de tous les genres du cinéma : noir fait pour les noir.es.
Puis vient l’épopée cinéma à plus large spectre, qui raconte les révoltes, met en lumière l’Histoire, éclaire la vérité de l’esclavage. C’est un tournant définitif.
Dans la chaleur de la nuit, Racines, Amistad, La Ligne verte, la Couleur des sentiments, Beloved, Twelve years of a slave, Malcolm X, The Birth of a Nation, Selma, Detroit …
On peut aussi citer les séries Marvel qui intègre cette diversification, en BD puis au cinéma.
Avec Django de Quentin Tarantino (cinéaste blanc largement biberonné, influencé par la Blaxploitation) et BlackKKKlansman j’ai infiltré le KKK, entre autres, on est sur la corde raide d’une bascule moins mélodramatique, plus abrasive.
Le genre emprunté – pseudo comédie à hémoglobine – propose un décalage cinématographique jouissif. Comme dans les westerns quand les indiens devinrent aux yeux des producteurs et du public américain des habitants autochtones, doués de raison, de légitimité et d’Histoire. Pas des scalpeurs de tête sauvages qu’on éradique sans sourciller et qu’on chasse de leurs terres ancestrales. Pas des « peaux rouges » assoiffées de vengeance ou voleurs de chevaux sanguinaires. Des amérindiens à la sagesse spirituelle millénaire.
Dans Django, emblématique à mes yeux d’un nouveau cap, la gravité du sujet ne cède rien à l’ironie moqueuse, au second degré et au retournement de stigmate. Dans ces films à la distribution mixte, le noir occupe une place centrale et déterminante. Sujet, héros complexe, la mise en scène lui rend honneur, ose souligner le ridicule et la lâcheté du blanc, les alliances malfaisantes, la bêtise du persécuteur et son échec final.
Puis, une mini révolution hollywoodienne se produit. Un nouveau genre nait sous nos yeux : le black horror !
Il fait son show, crève l’écran et donne ses lettres de noblesse à un genre franchement déconsidéré : le film d’horreur.
Woke horror et black horror se conjuguent en un reflet des préoccupations actuelles. Le black horror contribue à renouveler le genre de l’horreur. « Catégorie filmique en forme de divertissement sériel et commercial, qui fidélise particulièrement les ados du monde entier : le cinéma d’horreur » ou d’épouvante offre un écrin aux mots, silences et images à hauteur de pilori ; en une métaphore décalée des traitements sanglants infligés aux afro américains.
Les monstres sont de sortie, tissu cicatriciel en plan-séquence, contraste de couleurs et oppositions, c’est le choc, c’est esthétiquement troublant, intimement dérangeant. La peau des actrices et acteurs noirs est sublimée, mais filmée sans concession. Elle suinte, transpire, traduit le malaise, la douleur, la peur, l’horreur de ce qui se joue à l’écran. Malédiction, hantise, sortilèges, morts-vivants… la panoplie.
Tout y est, spoliation d’âme et assignation à l’enfer comprises.
Les parties les plus sombres de notre société sont ainsi plongées dans le noir autant que mises en lumière. Qui a peur du grand méchant… noir ?
La cruauté sadique, toute la perversité relationnelle du blanc envers le noir est mise en perspective à travers le genre de l’horreur. Celui-ci fait rayonner avec flamboyance et effroi la dénonciation, le déni d’humanité, les traumatismes ancrés, le retour du refoulé, la résurgence d’une mémoire transgénérationnelle marquée à vif.
Tout un peuple séquestré dans la maison horrifique des blancs, propriétaires tortionnaires vampiriques de leurs corps et fantômes, de leur esprits et âmes. Vrai cauchemar de damnation au long cours au service de l’Histoire, la vraie, véridiquement obscure !
On ferme les yeux, un frisson nous parcourt. On est face à l’Histoire. Qui s’échappera vivant de cette catharsis paradoxale, qui va chercher dans la cave la boite noire, la découvre et ouvre la boite de Pandore, trésor dissimulé, pourri, présent empoisonné. L’objet cinéma prend des allures de psychanalyse collective.
Get Out, Us, Antebellum, Lovecraft Country, Them, Bad Hair, Sinners… Vrai phénomène de réinvention filmique, de réappropriation de genre, de parabole de l’Histoire.
Une fois dépassé le regard ouvertement raciste ou condescendant de films correspondant à une époque de représentations stéréotypées des noirs à l’écran – De Au temps en emporte le vent à Devine qui vient diner – le cinéma vecteur de conscience, nous offre une magistrale surprise.
Formidable médium, la machine à rêve hollywoodienne, réinvesti par une communauté cinématographique woke, témoigne d’un changement d’époque, de paradigme et d’univers narratif.
Cette évolution relativement récente donne lieu à une immense créativité. Les producteurs la financent vu le succès mondial de ces films en salles.
Cette révolution suit son cours, en parallèle des revendications d’une population encore gravement exclue du rêve américain, fondé sur le cimetière des peuples autochtones et des Africains racialisés et déportés.
La résonance de ces films et du wokisme en Europe amplifie ce catalyseur d’une anxiété commune latente. On réalise que notre monde est horripilant.
Pourtant, cette angoisse partagée sonne le glas de l’ancien régime et met en mouvement une force collective, motrice d’un désir manifeste.
Il s’agit de nous relier de manière écosystémique à travers tous les arts, en une forme d’acculturation à la différence.
Devoir de mémoire, besoin d’Histoire et nouveaux récits sans tabou.