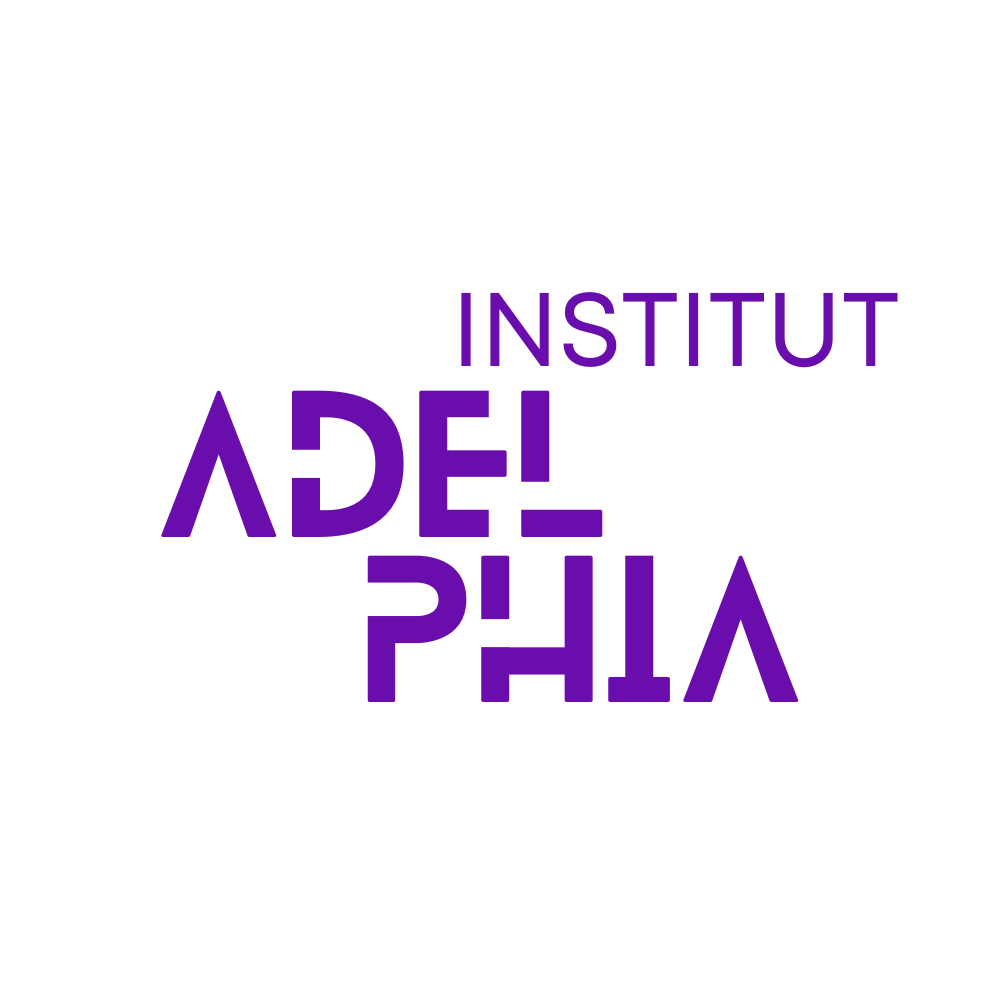Je rencontre les mots comme les personnes. Ils prennent sens à mesure que je les questionne. J’aime en identifier les usages. Au fil du temps ils signifient telle ou telle chose. Ils s’habitent différemment, investi d’un sens, puis d’un autre. Les mots sont vivants. J’entre en lien avec eux. Notre relation produit une résonance, un faisceau de sens. Les mots rétroagissent suivant la conjoncture, en macro-connaissance et en micro-intimité. Dans une forme d’introspection dynamique -passé-présent-futur, je conscientise ma pensée en mots, à bonne distance critique d’une définition toute faite, pour pouvoir raconter ce que j’entends par tel ou tel mot. Ici je vais mettre en perspective un mot qu’on n’arrête pas d’entendre : Transition. Attention récit-narratif de ma propre relation au mot.
Je me demande : Quand, dans quelles circonstances j’ai rencontré le mot transition pour la 1ère fois ?
J’entendais régulièrement à la télévision « Sans transition » dans la bouche de présentateurs-trices de JT ou d’animateurs d’émission de divertissement pour introduire un autre sujet, un autre artiste.
Cet idiome journalistique devenant une expression courante, entrant largement dans le domaine public -tout le monde l’utilise pour signifier qu’il passe d’un sujet à l’autre. Sujet qui ironiquement pourrait ne rien à voir avec le précédent OU au contraire aurait astucieusement été amené. « Sans transition » c’est comme un glisser-coller plus ou moins sérieux. Une astuce de langage en guise d’annonce. Transition m’évoque dans ce cas le transit et l’attente d’une nouveauté dans le flux-reflux des sujets. C’est un mot transfert, comme un mode transport.
Quand je suis à la Fac, ce mot revient sous l’angle des « transitions politiques » mises en place dans certains pays passés d’un régime à l’autre, suivant de nouvelles modalités de gouvernance. Transition traduit une rupture avec l’ancien : en attendant une transformation, on maintient le principal, mais on change progressivement certaines choses. Transition c’est du court terme.
La transition permet d’aménager les conditions de possibilité d’une nouvelle ère politique. Elle enclenche et favorise l’émergence d’un nouveau système.
Sans la brutalité inhérente à certaines révolutions, souvent à la suite d’une guerre, d’un coup d’Etat, la transition politique se réfère à la forme du pouvoir en train d’être modifiée. Elle intervient pour temporiser et tempérer les étapes du changement ; pour redistribuer les cartes du jeu politique selon une volonté régulatrice concertée. La transition n’est donc pas un passage à vide, elle est politiquement composite et équilibrante. Elle possède un contenu programmatique, porté par des acteurs politiques réformateurs, qui postulent généralement une meilleure répartition des rôles institutionnels… La transition dite démocratique raconte une histoire politique d’évolution positive, destinée au progrès social. Comme si la transition portait en elle des signes d’amélioration-qualité.
Aujourd’hui ce mot je l’entends toujours ; je le comprends autrement
Sociologue, j’entends les mots sur la fréquence socio-politique, voire philosophique.
C’est ma grille de préhension du monde, mon référentiel. Depuis quelques années, ce mot a investi le champ de l’étude des écosystèmes, par la voie d’alternatives proposées au développement capitaliste. L’altermondialisme a projeté ce mot au 1er plan des politiques publiques. Le modèle ultra libéral nous accule au changement, parce qu’il dévore les ressources, pille la Nature, surexploite et surconsomme. La planète est exsangue. « Transition écologique » occupe le sommet des sujets débattus et énonce une urgence programmatique. Ce mot monopolise l’espace-info, occupe les agendas politico-médiatiques. A tel point que l’Ecologie sans transition perd de sa valeur.
La transition écologique engage à mettre en œuvre des actions à la charge de chacun.e et de tous-toutes. Elle implique une responsabilité partagée à agir pour incarner concrètement le changement des comportements humains individuels et collectifs. Les politiques publiques l’intègrent comme axe d’action prioritaire. Cette forme de transition traduit la reconnaissance d’une relation systémique à l’Environnement et notre volonté de radicalement l’assainir.
– Reconnaissance de l’impact des activités humaines et de leurs conséquences sur l’environnement ;
– évolution du rapport au Vivant par la voie d’un regard critique sur les effets de nos systèmes d’exploitation, d’échanges, de consommation…
– et volonté d’initier des démarches rectificatrices pour modifier le lien de causalité nuisible entre l’humain et les autres écosystèmes.
C’est un rééquilibrage, qui témoigne d’une véritable progression de conscience et d’une vision planétaire élargie. La mondialisation a accéléré les dégâts occasionnés, mais permet aussi d’avoir une vision globale -effet papillon- qui promeut la transition écologique comme grande cause du 21ème siècle. Pendant thématique : le réchauffement climatique.
Sous l’angle socio-politique toujours, reste à voir la transition qui concerne Corps et Identité
Phénomène de société, la transition qui se réfère à l’identité de genre sort enfin du bois.
Je m’y étais intéressée assez tôt, à la suite de la lecture d’un très beau livre « MiddleSex ». Familière des milieux LGBT+, j’y côtoyais ponctuellement des personnes trans. Mais sans conscience immersive de leur réalité : ni par la terminologie qui se rapporte aux transitions, ni dans la pluralité/brutalité des expériences vécues par les personnes trans sur les plans familial, social, institutionnel… Je vivais plus en direct la réalité de mes ami.es Gay et lesbiennes et j’assistais impuissante, mais engagée au constat d’une différence mal jugée. Elles-ils vivaient des situations de discriminations, voire de violences. Quelques documentaires et films sur la transidentité m’ont fortement sensibilisée au sujet. Puis, récemment, j’ai rencontré une femme trans 😊…
Vue sous l’angle multi-dimensionnel, la transition de genre défie l’air du temps à laquelle les franges réactionnaires-conservatrices ne cessent de la réduire. L’appréhension ignare, réfractaire à toute spécificité, relègue d’emblée ce phénomène à la monstruosité (celle-celui qu’on montre du doigt) et au sectarisme contagieux. Quand on résiste à reconnaitre les droits des minorités, on érige naturellement en « trans-manie », en anomalie qualifiée de phénomène de mode et pourquoi pas de foire tant qu’on y est, une identité en émergence -l’identité de genre- alors qu’il s’agit d’une véritable révolution sociétale.
La méconnaissance se nourrissant ainsi d’un préjugé préjudiciable à la compréhension, au développement et à l’intégration de la différence. On ignore le parcours du combattant réservé à toute personne qui transitionne. Les personnes trans n’étant pas loin d’endosser le rôle de bouc-émissaire de l’incapacité du Politique à embrasser les évolutions sociales.
Des démarches administratives plus que fastidieuses, des relations aux proches totalement bouleversées, le poids du regard social subi et potentiellement violent, les conséquences en termes d’intégration professionnelle (discrimination latente) sont sous-estimées, voire ignorées ; elles sont pourtant le lot de toute transition. Le traitement hormonal n’est pas immédiatement acquis, le rejet de la famille représente un fort risque de déstabilisation psycho-sociale… Les hauts et les bas des personnes « en transition » – mégenrées- dépendent beaucoup de leur assise initiale : degré d’autonomie, puissance d’ouverture de leur réseau, entourage soutenant ou pas, acceptation professionnelle et familiale, situation financière… ça passe ou ça casse. Pas étonnant que le taux de suicides des personnes trans soit tellement élevé. 40%.
On a ici à faire à une transition subjective, singulière, aléatoire, faite d’une multitude d’étapes différemment vécues suivant le niveau de structuration de chaque personne. Coming-in : réaliser qui on est profondément, coming-out : oser le porter, l’exprimer, l’assumer publiquement, deuil de l’identité de genre assignée à la naissance, passing : se voir devenir qui on est et être reconnu dans sa nouvelle identité. Toutes ces phases actives ont des répercussions sur toutes les sphères de la vie courante. Chacun.e sa transition et ses différences. Mais les difficultés rencontrées sont largement communes.
J’ai souligné dans la série d’articles (épisode3) relatifs au Corps des Femmes, ce que la transition de genre apporte au mouvement féministe : un nouvel élan, en extension du domaine de nos luttes intersectionnelles. Elle élargit et recompose le spectre des féminités incarnées.
Contrevenant au code binaire, la transidentité résiste aux catégories étanches d’assignations biologiques et sociales. Les transitions de nos Adelphes introduisent une porosité dérangeante dans une société bornée-figée par des siècles de domination masculine et d’essentialisation discriminante. Les motifs d’inégalités socio-économiques ne peuvent plus être justifiés par femmes-hommes mode d’emploi : rôles sexués, distribution inéquitable des tâches, violences…
On sort du cadre. Toute transition-transfuge est une rupture avec la norme dominante, qu’elle fait imploser aux bénéfices de valeurs jusqu’alors disqualifiées parce que pseudo féminines : sensibilité, douceur, empathie, paix… La plus-value des transitions est celle de la diversité inclusive, mais elle charrie aussi contestation, déconstruction, nouvelles revendications et reconnaissance de droits.
Je continue d’en apprendre sur le sujet. Culturellement, il y a toujours eu des personnes trans, réduites au silence et/ou vouées à la mort sociale. Généralement discriminées-violentées, obligées de se cacher, plus rarement intégrées, selon le type de société concernée. Plus ou moins acceptées et reconnues en termes de statut social.
Ce qui relativise beaucoup la teneur polarisante des débats politiques autour de la question, particulièrement focalisée en France sur l’enfance en danger et l’influence perverse. Les personnes trans, au même titre que l’étranger, sont dotées d’un capital antipathie fondé sur la suspicion et le fantasme sexuel. Alors que l’enjeu de pouvoir juste exister en auto-détermination de son corps devrait proscrire toute idéologie d’arrière-garde.
Cibler l’inclusion, forme de transition vers l’inclusivité, devrait nous permettre collectivement d’opérer une véritable transition des mentalités, favorable à la liberté de choix et d’accès aux possibilités de transition. Pourvu que la nouvelle majorité de Gauche à l’Assemblée Nationale tienne ses promesses de faciliter la réalisation du changement d’Etat civil en mairie – par exemple, sans judiciarisation longue et contrôlante d’un processus volontaire.
Surtout, continuons de défendre l’idée de la liberté et de la dignité des personnes leur permettant d’exister en toute responsabilité sans subir de violences. Les femmes trans sont 3 fois plus harcelées/attaquées dans l’espace public que les hommes trans ; ce qui en dit long sur le paradigme viriliste assorti d’un privilège de genre privilégiant toujours le masculin.
Chaque avancée sociale transite par rejets, freins et résistances pour finalement être plus ou moins digérée. Pour l’instant la transition de genre concentre le jugement et la haine de l’Autre. Elle se heurte à un référentiel binaire, patriar-chaïste, colonisateur d’esprits fragilisés par des mouvements sociaux qui détricotent l’ancien régime. Nous sommes finalement tous-toutes en transition dans l’Histoire. D’où l’importance de l’éducation, de l’acculturation inclusive. La représentation valorisante des personnes trans, non-limitées au monde du divertissement et du spectacle, telle que Lexie historienne de l’art, Lou Trotignon humoriste, Morgan Noam psychologue et bien d’autres aura une influence décisive sur la scène politico-médiatique. Les réseaux sociaux facilitent ces prises de conscience et d’infos étayantes. C’est dans l’arène citoyenne que se joue ce combat pour la reconnaissance des droits des personnes trans.
Les drag-show sont de bons vecteurs de normalisation du phénomène. Mais ce sont bien les livres, témoignages, études et influences positives (prix d’interprétation gagné à Cannes par une actrice transgenre) qui permettront d’infuser le corps social pour essaimer et créditer pleinement la transition de genre comme une 3ème voie d’humanité possible et acceptable.
Le mot de la fin
Transition dans le champ professionnel : parcours de mobilité, reconversion. En transition vers…
Conclusion sur les TRANSITIONS
Au 1er abord on aurait dit un mot polysémique = à plusieurs sens. A y regarder de plus près il s’agit d’un mot ayant le même sens, mais se référant à des réalités phénoménologiques -c’est-à-dire en train de se vivre- différentes. Mot investi par le Politique, le Corps / l’Identité de genre, la Relation au Vivant, le Rapport au travail. Or, tous ces univers sont actuellement pris dans une onde de choc qui modifient considérablement nos espaces de pensée et de coexistence. Transition est le mot transverse, qui définit le mieux notre époque.
| TRANSITION signifie passage d’un stade à l’autre, comme une mue. Mouvement traversant, dynamique qui fait bouger les périmètres antérieurs. Processus de changement, mutation, impliquant des phases de transformation. Le but de la transition n’est-il pas de réaliser une progression ? Objectif à soi, objectif collectif, objectif d’évolution de notre relation au monde. La Sophrologie est un excellent moyen de transition. Méthode pédagogique d’action psycho corporelle, elle aménage de nouveaux espaces de vie, procure un nouveau regard sur l’existence, lève nos frontières, permet de mieux s’habiter en réinvestissant des relations à soi et aux autres plus en Harmonie. A portée holistique et réparatrice, elle est un outil de transmission de valeurs ouvertes et d’entrainement à transitionner vers un meilleur état d’être. Soyons trans 😊 Collaborons à notre propre éclosion, régénérons nos capacités, en soins-empathie envers tous et toutes. |